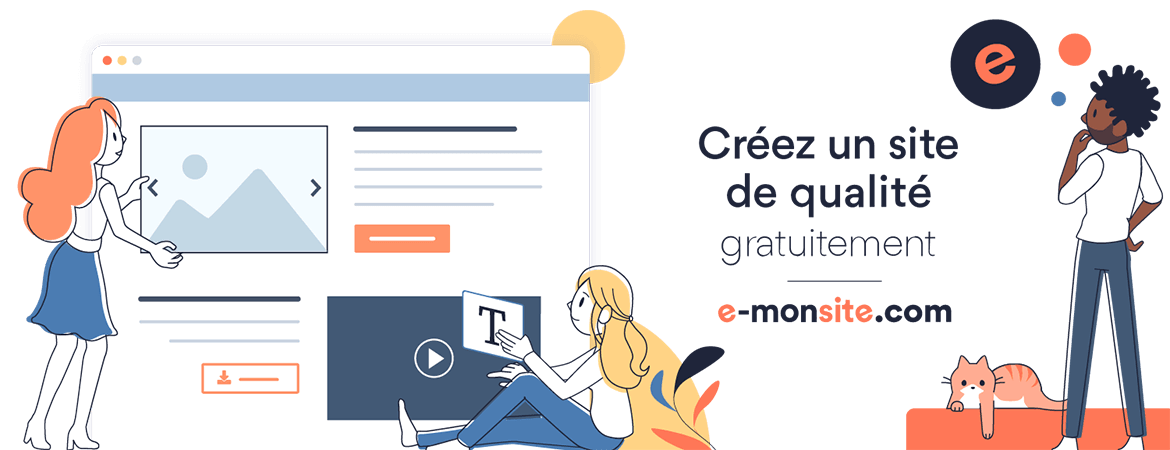Sécurité et proximité, deux impératifs difficilement conciliables ?
Sécurité et proximité, deux impératifs difficilement conciliables ?
INTRODUCTION
La sécurité participe à la qualité de la vie.
L’insécurité relève de l’économie, de la société et de ses valeurs. Police et gendarmerie ont revu leur organisation et leur fonctionnement pour lutter contre la délinquance et satisfaire la population. En ville, le contrôle social se heurte à l’anonymat. En campagne, il faut composer avec la démographie, l’agriculture et le découpage territorial. La notion de proximité apparaît dès 1829 chez les anglo-saxons. Il s’agit d’obtenir la coopération des habitants pour le respect des lois. Aujourd’hui, la police de proximité, communautaire, ou de résolution de problèmes selon les appellations, constitue une réforme des plus ambitieuses.
Si la sécurité sans proximité est difficilement concevable (I), ces deux notions révèlent parfois quelques antagonismes (II).
I. LA SECURITE SANS PROXIMITE EST difficilement concevable
La proximité intègre prévention, dissuasion et action décentralisée. En Angleterre, les groupes de surveillance dénommés Neighbourhood Watch ont vocation à alerter la police de tout problème. La coproduction de sécurité réoriente le contrôle social, les responsabilités de la police et de la communauté. L’anticipation, la résolution de problèmes, l’obligation de moyens, la restructuration des services, le partenariat doivent limiter la délinquance. En France, l’îlotage a amélioré la connaissance des quartiers et la lutte contre les atteintes aux biens. La police de résolution établit une analyse proactive des problèmes avec les solutions novatrices du système SARA (Scanning, Analysis, Response, Assessment).
Les gendarmes assurent en campagne la sécurité et la proximité, représentent l’Etat et remplissent avec leur famille, un rôle économique et social. Ils agissent souvent en médiateur-conciliateur même si les élus et la population reconnaissent leur moindre disponibilité et la diminution des patrouilles. Les brigades autonomes et communautés de brigades (COB) regroupent des brigades de proximité où l’accueil est limité à quelques demi-journées par semaine avec une zone d’intervention étendue. Pour limiter ce déficit de proximité, la gendarmerie a instauré des brigades territoriales de contact (BTC). Formés et dotés de nouveaux outils, les gendarmes œuvrent au profit de la police de sécurité du quotidien (PSQ) depuis 2018.
La police de proximité, mal définie, n’a pas permis de faire évoluer les mentalités policières à l’égard de la population.
II. SECURITE ET PROXIMITE DES NOTIONS ANTAGONISTES
Cette réforme, mal expliquée et accompagnée, a entraîné une désaffection progressive pour la proximité, limitée dans son impact et inégalement appliquée sur les territoires, notamment là où les relations police – population sont exacerbées. Cette situation renforce le sentiment d’insécurité et de compromission avec la population. La police de résolution de problèmes met en relief certaines carences de l’administration générant une inertie policière qui compromet le partenariat, assimilé parfois à de la délation. Les policiers restent mobilisés par l’ordre public et la criminalité mais peu par les dysfonctionnements sociaux que la proximité ne résout pas forcément.
Le virage technologique a augmenté la demande de sécurité et transformé le métier de policier : plus d’urgence, moins d’autonomie, un fossé entre la base et le sommet de la hiérarchie policière, l’essor de la sécurité privée et finalement la démotivation des fonctionnaires. L’action policière est demeurée corporatiste, réactive, résistante au changement et à la co-responsabilité de la sécurité. La prévention a fait long feu par manque de formation des agents assignés à des objectifs peu valorisants et sans capacité à peser sur certains facteurs de risque. L’absence de courage politique et de vision à long terme ont eu l’effet le plus délétère avec une évaluation lacunaire des réformes engagées.
CONCLUSION
L’action policière très encadrée par la loi et la déontologie pour satisfaire aux exigences de la population génère un malaise réel chez les personnels. La proximité, loin d’être la panacée annoncée, confine à l’idéologie politique. Son manque d’explication et son relatif échec sur la délinquance remettent en question sa pérennité.
Concurrencée par des modèles plus rationnels, elle pourrait voir son qualificatif abandonné pour des « réformes sur mesure » satisfaisant cette double attente de la police et de la population.
Ajouter un commentaire